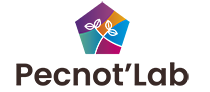Le sol est un matériau hybride au sein duquel les matières se transforment et se marient. On y trouve majoritairement des particules minérales issues de la lente altération des roches, ainsi que des matières organiques (racines, résidus de culture, etc.) qui sont produites, transformées et digérées par les organismes vivants. Mais ce milieu est également poreux, et ses volumes ne sont pas vides. Ils sont remplis d’eau lorsque le sol est trempé, et rempli d’air lorsque le sol est sec.
Combien d’air dans le sol ? 
Les sols ne sont pas tous égaux, dans leur capacité à contenir de l’air, et la proportion de vide qu’ils renferment varie dans l’espace et le temps. Elle dépend en partie de la taille et de la nature des particules solides. Par exemple, un sol caillouteux ou sableux est naturellement plus poreux, mais il s’agit surtout de pores de grande taille (de l’ordre de un millimètre de diamètre) qui permettent de drainer les flux. Au contraire, un sol argileux présente des pores de très petites tailles qui retiennent l’eau par capillarité. Certains argiles ont la propriété de gonfler lorsqu’ils sont humides et de se rétracter en séchant. Lors de cette rétractation, une partie de la porosité se referme, ce qui limite la circulation de l’air au cœur du sol. En parallèle, plus un sol contient de matières organiques, plus il peut contenir d’air, car ces matières sont elles mêmes poreuses, et en se dégradant elles laissent des volumes aérés au sein du sol. Enfin, les millions d’être vivants qui peuplent le sol (racines, lombrics, insectes, champignons, micro-organismes, etc.) creusent des galeries de toutes tailles, mélangent les matières, et dégradent les particules organiques mentionnées précédemment. Cette dégradation produit des substances nouvelles qui agissent comme une colle entre les particules. Elle forment ainsi des réseaux poreux solides et résistants. Si les sols ne sont pas tous égaux quant au volume d’air qu’ils contiennent, l’activité biologique améliore toujours l’efficacité du réseau poreux. Les organismes vivants sont les ingénieurs qui régulent ce réseau et permettent aux flux de circuler. Et pour cause, ils en sont les principaux bénéficiaires !
La vie a besoin d’air !
Dans un tel réseau, l’air est un peu confiné et circule lentement. Ainsi, à l’image de la fourrure d’un animal, le sol poreux est un excellent isolant thermique. Les variations de température ressentis en surface sont fortement atténuées dans le sol. Comme l’air circule lentement, l’eau du sol ne s’évapore pas trop vite, elle reste dans le sol soit à l’état liquide soit sous forme de vapeur. Cette ambiance stable, tiède et humide convient tout à fait aux organismes vivants ! Cependant, si l’air circule lentement, il reste essentiel qu’il circule. Car comme nous, les organismes vivants du sol ont besoin d’énergie. Pour cela, ils consomment de l’oxygène et rejettent du CO2. On parle de respiration du sol. Il est donc essentiel pour l’activité biologique que la porosité du sol reste connectée à l’atmosphère afin de garantir l’approvisionnement en oxygène.

Que ce passe-t-il si le réseau est en panne d’approvisionnement ? Lorsque le sol est noyé par exemple, alors racines et micro-organismes puisent l’oxygène contenu dans l’eau. Mais les gaz circulent mal en solution, et si l’eau n’est pas renouvelée, l’oxygène vient rapidement à manquer. On dit que le milieu devient anoxique. L’activité biologique est réduite car un grand nombre d’être vivant du sol ont un besoin absolu d’oxygène. C’est le cas des racines et de leurs mycorhizes notamment. Une partie des micro-organismes du sol est capable de s’adapter en pratiquant des métabolisme alternatifs qui mobilisent d’autres éléments que l’oxygène (CO2, nitrates, fer ferrique, etc.). Ces formes de métabolismes sont observées dans les zones humides, tourbières ou riziculture, mais elles sont sensiblement moins efficaces que l’oxygène, génèrent moins d’énergie, et produisent des substances toxiques parfois odorantes. C’est ce qui se passe dans votre compost, lorsqu’il n’est pas assez aéré ! Donc, comme en surface, les organismes vivants du sol ont besoin d’air. C’est une condition essentielle au bon fonctionnement de l’écosystème sol, et donc de l’agriculture qui en bénéficie directement.
Agriculture et air du sol
Comme nous l’avons vu, pour qu’un sol fonctionne au maximum de ces capacités et donc de sa fertilité, il faut un réseau poreux assez connecté pour laisser circuler l’air, mais pas trop aéré pour que le fonctionnement biologique soit optimale et permette de réguler le système. Cette régulation prend du temps, et cette lenteur relative n’est pas toujours acceptable au regard des objectifs de production agricoles. C’est notamment pour cela qu’on travaille le sol. Mais observons de plus près les impacts du travail du sol sur l’aération du réseau.
Qu’il gratte, fende, retourne ou émiette, tout travail du sol créé une porosité plus importante sur l’épaisseur accessible par les outils. Mais le travail du sol impacte également l’équilibre de l’écosystème sol tout entier. Les êtres vivants sont soumis à des conditions nouvelles : destruction des habitats, températures et humidité changeantes, prédations. Après le travail du sol, ce dernier est donc plus aéré, mais cette aération est très intense et vient perturber le fonctionnement en place. Les populations bactériennes, moins sensibles à ces changements ont tendance à se développer. Dopées à cette oxygène soudainement disponible, elles minéralisent intensivement les matières organiques présentes. A cours termes, cela a pour conséquence de libérer les minéraux contenus, et d’en faire bénéficier les plantes cultivées. Mais si ces matières organiques ne sont pas compensées par des apports, leur stock diminue, et à long terme, la colle organique qui solidifiait l’architecture du réseau vient à manquer. Il en résulte des sols à la structure fragilisée et donc sensibles à la dégradation. Il n’est pas rare de voir quelques jours après la préparation d’un lit de semence, la formation d’une croûte de battance en surface. Les agrégats nouvellement créés par le travail du sol ne sont pas assez solides pour résister à l’impact des gouttes de pluie. Leur destruction produit des particules fines qui se se scellent au séchage, formant une croûte quasi imperméable qui limite les échanges entre l’air du sol et celui de l’atmosphère, et donc la respiration du sol. Les sols à structure fragilisées sont également plus sensibles aux tassements, autre conséquence néfaste du travail du sol sur son aération. La pression exercée par le passage d’engins écrase la matière et détruit les réseau poreux en place. Cette destruction peut être très intense même en un seul passage. Elle peut se propager en profondeur et atteindre des niveaux de compactions quasi irréversibles à l’échelle de temps humaine. L’effet « décompacteur » de l’activité biologique ne peut s’envisager que sur le long terme (une à plusieurs décennies au minimum), et il en va de même pour les racines des couverts végétaux.

Au final, pour compenser l’impact désastreux du travail du sol sur son aération, l’agriculteur n’a pas d’autre choix que… de travailler le sol encore, perpétuant ainsi un cercle vicieux dont il est la principale victime. Pour sortir de cette situation, des pratiques agricoles visant à réduire le travail du sol et favoriser l’activité biologique se développent (semis direct sous couvert, maraîchage en planches permanentes, etc.). Dans tous les cas, la réduction de l’intensité du travail du sol (profondeur, nombre de passage, etc.) apparaît comme un préalable indispensable à la reconstruction progressive d’un réseau poreux durablement aéré. C’est l’un des enjeux cruciaux de notre agriculture : nourrir les humains sans faire étouffer les sols !