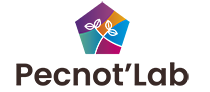D’où viennent les MO du sol ?
Les MO ne sont pas présentes dans les roches. Elles sont issues des organismes vivants. La plus grande partie des MO qui arrivent au sol provient des plantes. Il s’agit soit des tissus aériens qui tombent en surfaces après leur mort, soit de racines mortes ou d’exsudats qui arrivent directement dans le sol. Il est à noter que les matières souterraines contribuent plus à la teneur en MO du sol que les apports de surface.
En contexte agricole, l’apport d’amendements organique, ou les résidus de culture constituent la majorité des entrées de MO dans le sol.
Composition et constitution des MO en entrée.
Les MO qui arrivent au sol sont composées de cellulose, d’hémicellulose, de lignine, lipides, protéines, etc. Les plantes libèrent également d’autres substances composées de petites molécules appelées métabolites (acides organiques, tannins, polyphénols, etc). Ces petites molécules jouent un rôle crucial dans la nutrition des micro organismes.
Les MO arrivant au sol ont des composition variables. Ainsi par exemple, les tissus morts n’ont pas la même composition que les tissus vivants, car la plante redistribue certains éléments minéraux pendant la sénescence (en particulier des sucres et des composés azotés) tout en laissant principalement des composés structurels riches en C. Les tissus végétaux jeunes sont riches en glucides simples et en matière azotées. Les tissus âgés sont riches en substances complexes à évolution plus difficile (cellulose, lignine, tannins, …) et pauvre en protéines. De la même manière, le fumier vert issu de tissus vivants fraîchement coupés diffère des autres intrants végétaux. Les produits microbiens sont généralement composés des mêmes molécules que les produits végétaux, à l’exception des composés de cellulose et de lignine. Les produits microbiens sont généralement enrichis en polysaccharides, lipides, protéines, et métabolites.
La transformation des matières organiques dans le sol.
Une fois ces matériaux nouveaux déposés dans le sol ou à sa surface, ils vont être progressivement fragmentés, mélangés, incorporés par l’action des organismes vivants du sol. C’est avec une grande complémentarités, que ces derniers vont se succéder dans cette tâche.
La macro faune (organismes vivants invertébrés de taille supérieur à 2mm) va être responsable de la fragmentation des particules les plus grosses. Il en résulte des particules organiques plus fines mais conservant en grande partie leur composition chimique d’origine. La macro faune va également déplacer et mélanger les particules organiques avec les particules minérales du sol. Enfin, au sein des appareils digestifs des agents de la macro faune, les particules organiques vont entrer en contact avec des micro-organismes et connaître des transformation biochimiques.
Les micro-organismes sont les principaux responsables de la transformation biochimique des MO du sol. Les micro-organismes représentent la plus grande biodiversité des organismes vivants du sol. On estime que dans un gramme de sol, on retrouve 1 milliard de bactéries appartenant à 1 millions d’espèces différentes, ainsi que des dizaines de mètres de mycélium de champignon appartenant à 1000 espèces différentes. La biomasse microbienne (c’est à dire la masse des micro-organismes du sol) représente quelques centaines de grammes de matière sèche par m² de sol. La rhizosphère (zone à proximité des racines) concentre la plus grande activité microbienne. Généralement, la biomasse microbienne est plus faible dans les sols cultivés et explique en partie la plus faible quantité de carbone dans les sols.
La meso faune du sol (taille comprise entre 0,2 et 2 mm) complète le réseau trophique et joue un rôle important dans la régulation des populations microbiennes.
La dégradation des particules organiques est le résultat de réactions chimiques catalysées par les enzymes produites par les micro-organismes. Ces dégradations ont tout d’abord lieu en dehors des cellules des micro-organismes. De ce fait, la proximité directe à l’échelle microscopiques entre les particules organiques et les populations microbiennes est un pré requis indispensable pour que ces réactions aient lieux. Les dégradations des particules organiques consistent en des phénomènes d’oxydation ou d’hydrolyse. Évidemment, les condition physico-chimiques du milieu jouent un grand rôle dans la présence des micro-organismes et leur activité de dégradation (pH, température, humidité, oxygène, etc.). Si la dégradation des molécules organiques est totale, alors ces dernières sont minéralisées, c’est à dire que les éléments minéraux qui les constituent sont libérés. Dans ce cas, on ne parle plus de matières organiques mais d’ions, ou de molécules minérales (H2O, CO2, etc.).
Les plus petites molécules organiques peuvent être transportées à l’intérieur des cellules des micro-organismes et subir des transformations plus poussées. Il s’agit notamment de synthèse de nouvelles molécules organiques issues de leur combinaison. Ces molécules nouvelles peuvent soit entrer dans la constitution des cellules des micro-organismes, soit constituer de nouvelles métabolites libérées dans le sol. Ainsi, les matières organiques sont constamment recyclées
Déplacement et répartition des MO dans le sol
En plus de leurs transformations, les matières organiques subissent des déplacements constants au sein du sol. Les agents de transports principaux sont la faune et l’eau.
Les déplacements de MO au sein du sol sont regroupés dans un processus nommé bioturbation. Il s’agit du mélange de matières lié à l’activité biologique. La macro faune, de taille plus grande est forcement responsable de déplacement de matière plus importants. Ce processus de mélange décroît rapidement avec la profondeur et devient négligeable à des profondeur > 1m.
L’eau qui se déplace au sein de la porosité du sol est également un vecteur important de transport des MO. Plus les particules organiques sont fines, plus elles sont mobilisables par l’eau. Les particules < 0,45 µm sont appelées MO solubles.
D’une manière générale, la répartition des MO dans le sol se concentre en surface et décroit fortement vers les horizons profonds.
Des molécules en transit
Les MO du sol désignent donc une gamme très diversifiée de composés organiques, allant de la matière organique particulaire aux composés élémentaires constitutifs des micro-organismes (sucres simples, composés polyphéniques, acides aminés, acides gras, etc.). Ces molécules sont à différents stages de biotransformation, et les molécules les plus simples peuvent être assemblées en supramolécules complèxes.
Les recherches récentes ont montré que les composés d’origine microbienne ont une durée de vie plus importante que les composés issus des tissus des plantes. L’activité micro-biologique joue donc un rôle crucial dans la production de la MO stable du sol.
La dégradation progressive des molécules organique conduit systématiquement à une réduction de la taille des molécules mais aussi à une augmentation de leur solubilité dans l’eau et de leur réactivité chimique. Ces propriétés sont essentielles en ce qui concerne leur capacité à former des associations organo minérales.
Stabilisation des MO
Les interactions entre matière organique et fraction minérale sont le facteur clé de la stabilisation des MO dans le sol. C’est notamment le cas des particules de diamètres < 2 µm (argiles granulométriques). Comme vu précédemment, ces particules rassemblent une grande diversité de matériaux. Les argiles minéralogiques (phyllosilicates) et les oxyhydroxydes sont le plus impliqués dans les association organo-minérales. Les MO stabilisées sont essentiellement des molécules très petites issues de l’activité micro-biologique. Ces micro particules organiques se fixent par adsorption en petits patchs à la surface des minéraux. Cela forme des complexes organo-minéraux.
Qu’il s’agissent de pont cationiques ou de liaison directes, les liaisons entre MO et particules minérales sont très fortes et protègent les MO de l’action enzymatique issue de l’activité biologique.
Minéralisation des MO
La minéralisation des MO du sol est le résultat de la respiration des excrétions inorganiques liées à la dégradation des MO par les micro-organismes. Il en résulte la libérations d’ions, ou de molécules minérales (H2O, CO2).
Dans point de vue global, on estime que la respiration des sols émet 10 fois plus de CO2 que les activités humaines (IPCC, 2013).
Durée de vie des MO dans le sol
De leur arrivée dans le sol jusqu’à leur minéralisation totale, les MO ont des temps de résidence variables en fonction.
– de leur nature
– de l’intensité de l’activité biologique
– et donc des condition pédoclimatiques (climat, pH, etc.)
Certaines MO sont recyclées très rapidement (quelques semaines), tandis que d’autres ont des temps de résidence beaucoup plus long (milliers d’années). Il s’agit notamment des molécules organiques de très petites tailles qui sont fixées durablement aux particules minérales, ou encore des particules organiques qui ont migré plus en profondeur et sont plus éloignés des grands pôles d’activité biologiques.
La teneur en MO : un état des stocks
L’évolution du stock de carbone organique dans les sols résulte de l’équilibre entre les apports de matières organiques végétales au sol et leur minéralisation.
MO du sol et cycle du C
Le sol représente le plus grand réservoir de carbone de la biosphère continentale contenant environ deux fois le stock de carbone atmosphérique et trois fois le stock de carbone contenu dans la végétation (40 tonnes par hectare (t/ha) en sols cultivés et 65 t/ha sous prairies). Une augmentation des stocks de carbone organique des sols cultivés peut jouer un rôle significatif dans la limitation des émissions nettes de gaz à effet de serre vers l’atmosphère en stockant du CO2 atmosphérique dans la MO des sols.