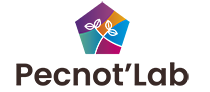On pourrait croire que le sol n’est qu’une surface inerte uniquement composée d’éléments minéraux, alors qu’en réalité, ça grouille de vies ! Lorsque nos pieds foulent le sol, ils entrent en contact avec les innombrables habitants le constituant. La diversité de micro-habitats du sol fait de lui un grand réservoir de biodiversité. En effet, ¼ des espèces décrites à ce jour font partie de la faune du sol.
La biodiversité du sol regroupe la faune et les micro-organismes du sol. Parmi ces organismes, certains se voient à l’œil nu, d’autres pas. Pourtant, tous ont des rôles essentiels et complémentaires. Ils participent au bon équilibre de l’écosystème sol.
Il est important de s’intéresser à l’organisation et au fonctionnement de la vie du sol si on souhaite en prendre soin. On vous propose ici d’entrer petit à petit dans les profondeurs du sol pour découvrir ses habitants et leurs mystères.

Lorsqu’on se penche pour observer le sol, les premiers habitants que l’on peut croiser sont ceux qui vivent à la surface du sol. Ils constituent la faune dite épigée. Araignées, acariens, limaces, vers de terre, cloportes, collemboles, larves d’insectes, carabes… et bien d’autres encore se promènent entres les brins d’herbe et les feuilles mortes.
Cette interface entre le sol et la litière, appelée la détritusphère, est un des trois « hot spots » de biodiversité du sol.
Dans cette zone de haute activité biologique se trouvent des espèces dites détritivores. Leur rôle est de manger tout ou partie de ce qui se trouve à la surface du sol. Elles vont fragmenter la matière organique chacune à leur manière. D’abord, de gros collemboles vont découper grossièrement la matière. Ensuite, des cloportes vont la découper plus finement. Enfin, de plus petits collemboles vont finir minutieusement la découpe. De cette manière, la matière organique qui tombe au sol est petit à petit réduite en fragments microscopiques mélangés dans les premiers centimètres de sol. Les détritivores participent donc au microbrassage de la matière.
Les déjections des détritivores, riches en matière organique, vont être une source de nourriture pour des micro-organismes du sol, tels que des champignons et bactéries. Ces derniers vont, par un processus appelé « minéralisation », extraire et restituer les éléments minéraux de la matière organique. Ils participent à l’étape ultime de recyclage de la matière.
Dans la détritusphère, on trouve également des prédateurs. Alors non, pas de lion à l’horizon ! On trouvera plutôt des carabes et des acariens. Ces prédateurs, malgré leur très petite taille, jouent un rôle essentiel de régulation des populations de détritivores.
Si on s’enfonce un peu dans le sol, jusqu’aux racines des plantes, on entre dans un monde à part, où règnent des organismes microscopiques. Ce monde, à l’interface entre le sol et les racines, s’appelle la rhizosphère. Celle-ci constitue un autre « hot spot » de biodiversité du sol.
Les principaux habitants de cette zone sont les micro-organismes. Ils vivent la plupart du temps en association avec les plantes. Leur présence est essentielle car ils permettent une meilleure survie de la plante en cas de stress.
Parmi ces micro-organismes se trouvent les champignons mycorhiziens. Ils ont un partenariat bien spécifique avec les plantes, qui consiste en des bénéfices réciproques, on parle d’association symbiotique. Ces champignons vont puiser dans l’environnement de l’eau et des nutriments, qu’ils communiquent à la plante. En échange, la plante fournit du sucre aux champignons.
De la même manière, d’autres micro-organismes, les bactéries de la rhizosphère, se nourrissent des exsudats racinaires (substance sucrée sécrétée par la plante) et en échange décomposent la matière organique en nutriments qui sont alors assimilables par la plante.
Dans la rhizosphère, on trouve également des prédateurs quasi microscopiques : les nématodes. Ce sont des sortes de vers d’à peine quelques millimètres de longueur qui vont participer à la régulation des populations de micro-organismes dont ils se nourrissent.
Le troisième et dernier « hot spot » de biodiversité du sol est la drilosphère. Cette zone de haute activité biologique est sous l’influence des vers de terre.
Concrètement, ce sont les galeries et autres constructions issues de l’action des vers de terre. Ces derniers sont bâtisseurs et habitants de cette zone si particulière. Ils participent au macrobrassage de la matière organique : ils enfouissent la matière organique présente à la surface dans les profondeurs du sol, et excrètent leurs déjections organiques à la surface, formant des tortillons appelés turricules.
Les turricules, riches en matière organique, vont être une source de nourriture pour des micro-organismes du sol, tels que des champignons et bactéries. Ces derniers vont, par un processus appelé « minéralisation », extraire et restituer les éléments minéraux de la matière organique. Ils participent à l’étape ultime de recyclage de la matière.
Les vers de terre sont considérés comme les ingénieurs de l’écosystème sol, du fait de leur capacité à créer des habitats. Ils participent à moduler la disponibilité des ressources en eau et en matière organique.

Turricule
Les habitants du sol contribuent aux fonctions écologiques essentielles de structuration du sol, de régulation du cycle de l’eau, du carbone et des nutriments, de régulation biologique. Ils contribuent au bon fonctionnement du sol qui lui-même assure à une échelle plus large des services écosystémiques.