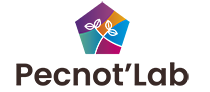La plupart des gens foule le plancher des vaches sans réaliser à quel point il nous est utile. Le sol et la multitude de micro-organismes qu’il abrite forment la base de l’ensemble des écosystèmes terrestres. Les avantages ou services écosystémiques que l’homme peut tirer du sol sont innombrables (production alimentaire, stockage et purification de l’eau, rétention des gaz à effet de serre, etc.). Malheureusement, le développement de la société humaine s’est accompagné d’une gestion très controversée de ce précieux écosystème. En quelques décennies l’agriculture intensive et l’artificialisation des terres ont dégradé près d’1/3 des terres cultivables dans le monde. Quels sont les enjeux de cette tendance à la dégradation des sols et des terres arables ?
Le premier impact qui nous vient à l’esprit lorsque l’on parle de dégradation des sols est celui de la production alimentaire. En effet, 95% de notre nourriture provient de façon plus ou moins directe du sol, c’est pourquoi il est si important de préserver les terres arables. Pour répondre aux besoins de notre croissance démographique galopante, l’agriculture s’est adaptée notamment en développant un mode de (mono)culture intensif couplé à une utilisation abondante de fertilisants azotés. Ces techniques sont très efficaces à court terme, mais dans la durée elles dégradent le sol et diminuent fortement sa fertilité. En perturbant les cycles biogéochimiques des écosystèmes du sol, l’avantage immédiat de ces techniques se retourne en menace contre ses auteurs. Des sols fertiles ayant pris des milliers d’années à se former ont été détériorés en l’espace de quelques décennies par l’activité humaine.
Tout cela n’est pas sans conséquence ! Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’érosion et la dégradation des sols pourraient faire baisser les rendements des cultures jusqu’à 50%. En 2015, la FAO estimait à 50 milliards de dollars par an le cout de cette baisse de fertilité à l’échelle mondiale. Les enjeux soulevés ici sont capitaux, si rien n’est fait nous lèguerons aux générations à venir des sols en mauvaise santé, incapables de répondre à la demande alimentaire croissante.
La dégradation et l’artificialisation des sols menacent une autre ressource très précieuse : l’eau. Entre les villes qui se couvrent de béton, le réseau hydrographique qui se chenalise et les sols agricoles qui s’imperméabilisent à cause des techniques de labourage, l’eau issue des précipitations a de plus en plus de mal à s’infiltrer dans le sol. Au contraire, elle lessive les terres en emportant avec elle une partie du sol. Non seulement ce lessivage accélère le processus d’érosion mais en plus de cela il charrie avec lui le surplus des engrais (azote, phosphore) utilisés par le secteur agricole. Tous ces éléments finissent dans les cours d’eau provoquant l’eutrophisation des rivières et l’asphyxie des écosystèmes aquatiques. La prolifération annuelle de l’algue verte Ulva armoricana sur les côtes bretonnes est un exemple type d’eutrophisation.
Au-delà des considérations écologiques, le lessivage des sols représente également un enjeu sanitaire et économique majeur. Ainsi, en 2011 le commissariat général au développement durable estimait que les surcouts liés à la dépollution des eaux coutaient chaque année 1,5 milliards d’euros aux ménages français. La préservation de nos écosystèmes aquatiques et de la qualité de notre eau passe donc avant tout par une bonne gestion du sol.
Le sol est un formidable réservoir de biodiversité, il abrite à lui seul près d’un quart des espèces animales vivant sur terre ! Cette multitude d’organismes nous fournit une quantité incroyable de services écosystémiques. Le sol est en fin de compte une grande usine qui tire sa force de la diversité de ses ouvriers (bactéries, arthropodes, lombrics, etc.). Malheureusement, la biodiversité du sol est l’une des premières victimes de la dégradation des terres. Érosion, appauvrissement du niveau de matière organique et modification de la nature géochimique du sol forment un cocktail extrêmement délétère pour la diversité des organismes du sol. Un sol dégradé produira en moyenne 25% de matière organique en moins qu’un sol en bonne santé. Couplé au changement climatique, cette chute de la fertilité des sols devrait conduire en 2050 à des baisses de rendements agricoles allant de 10 à 50%.
A l’échelle mondiale, l’effondrement de la biodiversité du sol est également une réelle bombe climatique : la diminution de la faune du sol capable de séquestrer le carbone et de le rendre bio-disponible laisse la terre émettre des quantités phénoménales de CO2 dans l’atmosphère. C’est la double peine, moins de matière organique et donc moins de fertilité mais plus de gaz à effet de serre. La lutte contre le réchauffement climatique doit se faire sur tous les fronts y compris celui de la préservation de l’écosystème sol.
Nous avons pu voir à quel point la santé des sols était primordiale au bon fonctionnement de notre société. Mais nous avons également constaté combien cet écosystème était fragile. La sécurité alimentaire, l’aggravation du réchauffement climatique ou encore la préservation de la biodiversité sont autant d’enjeux soulevés par la dégradation des sols. On estime que l’altération des services écosystémiques due à cette dégradation du sol et de la biodiversité coûte chaque année 10% du PIB mondial. Cette facture est vouée à s’alourdir si nous ne repensons pas notre manière de gérer le sol.
Heureusement il est encore temps d’agir ! La solution passe d’abord par une prise de conscience et une meilleure compréhension du sol. Bien gérer sa terre c’est avant tout bien la comprendre. D’un point de vu pratique, la rotation des cultures, la réduction du labour au strict minimum ou encore l’usage raisonné des intrants doivent être privilégiés. C’est en additionnant ce type d’actions que nous pourrons restaurer et préserver le sol pour les générations futures.